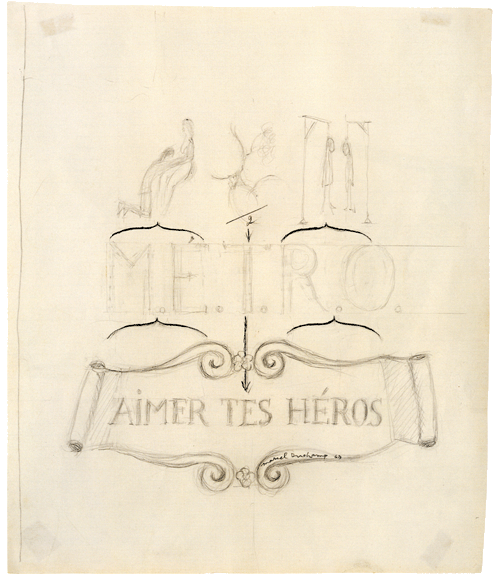C'était une charge qui se transmettait de père en fils depuis des siècles et donc un jour elle a voulu aller voir les Savoyards. Donc, elle m'a emmené. Elle a regardé, elle a vu des bijoux, des meubles et elle a parlé avec ces Savoyards et moi je suis tombé dans une salle de tableaux modernes (ce qu'on appelait les tableaux modernes, c'était surtout de l'entre-deux guerres on va dire, début du 20e siècle) et ça m'a saisi - je ne sais absolument pas pourquoi ! J'étais fasciné par ce que j'ai vu. Je crois que je n'avais jamais imaginé, justement parce qu'il n'y avait pas d'art chez moi, qu'il y avait autant d'expressions possibles avec le même médium. Je n'y avais seulement jamais réfléchi mais ça m'a fasciné et j'ai acheté le catalogue. Quand je suis rentré chez moi, mes parents n'avaient pas de livre d'art mais ils avaient une encyclopédie en 30 volumes que mon père avait acheté mois après mois. Là-dedans, j'ai cherché tous les artistes et j'en ai trouvé plein : Jacques Villon, Rouault... ! Ça m'a ouvert un horizon, comme si j'avais découvert une famille inconnue ! Puis, je suis allé deux fois par semaine à Drouot, j'ai demandé à ma mère de m'accompagner. Dans les embouteillages, je lui parlais de ce qu'on allait voir, on décortiquait les catalogues. Ça faisait une espèce d'émulation, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Puis de fil en aiguille, je suis allé dans des musées, des galeries, j'ai rencontré des artistes, tout a découlé de là. La plupart des gens avec qui je m'entends bien dans le milieu de l'art ont un rapport privilégié avec l'objet. C'est vrai que je n'ai pas commencé dans les livres ni à l'école, mais bien par les objets : le mystère des objets me fascine toujours. Des objets qui étaient muets car à Drouot, tu n'as même pas de cartel. C'est ce que j'adore à Drouot : tu entres dans une salle, tu as 300 œuvres montrées de la pire manière possible, une croute supposée à côté d'un chef-d'œuvre supposé. Tu n'as que tes yeux qui travaillent, mais parfois tu te dis : « cette supposée croûte qui vaut 200 euros, elle me plaît beaucoup plus que ce soi-disant chef d'œuvre qui en vaut 200 000. » Ça pousse à faire travailler l'œil, c'est une école de l'œil.
C’est là où j’ai commencé à écrire aux artistes pour obtenir de la documentation sur leur travail et les prix (car à Drouot contrairement aux musées et salons, il y avait toujours l’estimation qui était comme un juge de paix sur un état de l’offre et de la demande). J’avais la hantise de rencontrer un jour un artiste car j’estimais que je n’avais pas du tout de formation académique, je me sentais illégitime. Je pouvais être ignorant en face d’un objet, ce n’était pas gênant, alors que me sentir ignorant en face d’un artiste ! C’étaient comme des idoles. J’avais peur de ne pas être à la hauteur.
Longtemps après, j’ai compris pourquoi. J’ai fait une expo quand j’avais la galerie Météo, ouverte en 1992, qui s’appelait Les Première pierre. J’avais demandé à des artistes de me confier l’œuvre à partir de laquelle ils avaient su qu’irrémédiablement ils seraient artistes toute leur vie. L’œuvre avec laquelle leur vie avait basculé. Et c’était assez troublant car la plupart m’ont confié des œuvres de jeunesse et je me suis trouvé entouré de ces œuvres un peu imparfaites car elles étaient élaborées avant que l’artiste ait trouvé son style. Et j’ai découvert qu’il y avait un point commun à toutes ces œuvres, c’est qu'elles étaient bêtes, stupides d’une certaine manière. Ça m’a fait penser au livre qu’a écrit Jean-Yves Jouannais plus tard sur l’idiotie et je pense qu’effectivement on peut être artiste, pas du tout si on est bête, mais en tous cas si on ne cherche pas à être intelligent. Il faut faire arriver à faire quelque chose en s’en foutant de ce que les gens vont en penser. C’est un peu comme quand on danse, si tu penses à ce que les gens vont en penser, tu restes debout et tu sirotes ton gin tonic ! Soit t’es complètement dans ce que tu fais, comme quand tu fais l’amour, comme quand tu danses, comme quand tu fais de l’art... Si tu n’es pas complètement dans ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Et moi, je n’étais pas capable d’être que dans ce que je faisais quand je faisais quelque chose avec mes mains. Et donc, je me suis dit : « qu’est-ce que je peux faire ? ». Je voulais en tous cas être très proche de l’art, sans en faire. La galerie est ce qui permettait à la fois d’être essentiel dans le destin d’un artiste. Evidemment, comme je dis toujours, ce n’est pas nous qui découvrons les artistes, ils se découvrent tout seul. Mais un artiste a besoin d’être montré pour que son travail existe. Qui peut prendre le plus rapidement, simplement, individuellement la décision de montrer un travail ? C’est un galeriste. Je voulais être utile aux artistes et en même temps, les accompagner dans la durée. À travers la lecture de cette encyclopédie, ce qui m’intéressait c’était une vie, un parcours d’artiste qui commence à un point A et qui finit à un point B. J’ai toujours dit qu’un bon artiste, c’est un artiste qui est bon de A à Z. Je ne crois pas à un artiste qui soit excellent 5 années de sa vie... Y’en a qui sont excellents 5 années de leurs vies et épouvantablement mauvais le reste du temps. Mais pour moi quand je les regarde avec la connaissance de tout leur parcours, en général - même toujours -, je juge qu’ils ont été mauvais tout le temps. Simplement, pendant quelques années, ça ne s’est pas vu car ils étaient dans un groupe, dans un endroit où il se passait des choses. C’est un peu comme Ringo Starr : il était génial avec les Beatles, mais ce qu’il a fait tout seul n’a aucun intérêt. C’est un peu pareil avec certains Nouveaux Réalistes, ou certains Impressionnistes, qui ont participé pleinement à une aventure mais qui au final n’avaient rien à dire tout seuls.
Et là, elle devait préparer un catalogue. Elle avait fait venir un photographe à la Galerie et elle avait apporté avec elle dans sa valise toutes les œuvres de Supports/Surfaces (car comme c’étaient que des toiles libres, c’était facile à déplacer contrairement aux œuvres de la Figuration Narrative). Elle a déplié et punaisé les œuvres au mur. Le photographe photographiait un Pincemin, un Devade, un Deleuze, un Viallat… Moi je ne connaissais pas la plupart de ces artistes car ils ne passaient pas en vente à Drouot, ils étaient beaucoup trop avant-gardistes pour moi à l’époque. Et, il y a une œuvre qui m’a subjugué. De Noël Dolla. Rétrospectivement, c’est très mystérieux...
Il était prof à la Villa Arson à Nice, donc il avait quand même un contact avec l’art, avec des collègues, des élèves mais restait très isolé. Donc Noël m’a dit « Il faut venir voir ce que je fais ». Il était en pleine crise existentielle. Il avait créé 7 ou 8 alter-ego qui faisaient 7 ou 8 séries d’œuvres radicalement opposées les unes des autres. Il a fini par m’inviter à Nice une semaine pour que je voie ce qu’il faisait. J’ai sauté dans l’avion et il est venu me chercher en moto. Il conduisait comme un fou, j’avais tellement peur sur la Promenade des Anglais. Il me dit « On ne va pas aller chez moi directement, car il y a un vernissage dans une galerie, alors on y va! ». Je devais avoir 19-20 ans et on débarque dans cette galerie et on tombe sur deux étudiantes qui barraient l’entrée. J’ai buté sur elles. Il me les présente, c’était : Tatiana Trouvé et Ghada Amer, avec qui je commence à sympathiser. J’étais passé directement d’un artiste de 60 ans à un artiste de 45 ans et d’un coup à des étudiantes de 20, des apprenties artistes. Donc j’avais enfin rencontré des artistes de mon âge, après tout ce périple ! Je dormais dans la chambre d’ami de Noël, là où il y avait des cartons à dessins. Tous les soirs, je prenais un carton à dessin et je potassais, je regardais tout ce qu’il avait fait !
Quand elle est sortie, j’ai appelé sa secrétaire, j’ai pris rendez-vous avec Marie-Claude. Elle me donne rendez-vous à 9h du matin à Jouy-en-Josas, je viens, elle baille tout le long alors que je lui apportais ma revue tout tremblant. Et moi, il fallait que je trouve un stage de fin d’études. À la fin de la conversation, elle me demande : « Bon et maintenant, qu’est-ce que vous faites dans la vie à part cette revue ? ». Je réponds que j’ai fini mes études d’art et de commerce et que maintenant je cherche un stage. Elle me dit « Et vous avez des idées ? ». Je réponds que je ne sais pas trop et elle me dit « Vous ne voudriez pas venir ici ? ». Quelle bonne idée ! Donc, je débarque faire un stage de 3 mois, l’été 89. J’ai 21 ans et je suis à la Fondation Cartier. Trois mois de stages pour élaborer un projet de revue pour la Fondation Cartier. Je me plonge dans les archives, j’essaie de tout comprendre. En septembre Marie-Claude revient de vacances, j’avais bossé tout l’été et je présente mon projet de revue. Elle me dit « C’est super, c’est exactement ce que j’aurai voulu mais Cartier me retire le budget, donc il n’y a plus de revue. ». Mon stage se terminait et elle me propose de rester pour être chargé de mission pendant 1 an pour préparer l’exposition Warhol de l’été suivant.
Puis après, à l’époque, il y avait ce qu’on appelait le service militaire. Donc été 1990, mon CDD se termine et je pars au service. Un peu avant j’avais commencé à écrire dans les journaux, donc j’ai continué pendant que j’étais au service dans une revue qui s’appelait 7 à Paris un Télérama un peu rock, un peu plus intéressant. Puis quand je suis sorti de mon service militaire, la fondation avait commencé à se replier sur de gros projets, plus institutionnels, qui m’intéressaient moins. Je continuais à écrire dans les journaux. Mais je ne savais plus quoi faire parce que j’avais eu une première expérience tellement géniale, que je me suis dit « je vais forcément rétrograder ». Je me suis dit c’est foutu, il va falloir que je me tape 15 ans de galère avant de refaire quelque chose d’aussi intéressant. Ce n’était pas trop dans mon caractère donc j’ai décidé de monter ma galerie. C’est comme ça que tout ça a commencé ! En parallèle, juste avant que je fasse mon service, est arrivée la Guerre du Golfe et la crise du marché de l’art en janvier 90. En sortant de mon service en 1991, ça faisait déjà plus d’un an que le marché est totalement déprimé. Il y a eu un effet de coup de tonnerre parce qu’à la fin des années 80, au contraire, le marché se portait super bien, il était très spéculatif - rien à voir avec ce que c’est aujourd’hui mais à l’époque, ça paraissait très spéculatif - donc les galeries se créaient comme des champignons. Et puis, là, 90, coup de froid total parce que là, du jour au lendemain, tout s’arrête avec la guerre du Golfe : la bourse s’effondre, l’immobilier s’effondre, l’art s’effondre. Tout était cyclique et non pas contracyclique comme l’art l’est devenu. Les galeries ferment, tous les projets de galerie s’arrêtent et tous ces jeunes artistes que j’avais connus à Nice et qui maintenant sortaient de l’école ne trouvent pas de galerie ! Pourtant ils sont tout à fait repérés. À l’époque, au Musée d’art moderne, il y avait une manifestation, les Ateliers de l’ARC, qui avait lieu tous les 4 ans et qui montrait la fine fleur des artistes français émergents sous la houlette d’un commissaire étranger. En 1991, il y avait Ghada Amer, Mayaux, Ramette, Jean-Luc Blanc - beaucoup de ces artistes que j’avais connu à Nice étaient là. Habituellement, ces artistes trouvaient immédiatement des galeries, mais cette année-là, comme il n’y avait pas de nouvelle galerie et que beaucoup avait fermé, quasiment aucun artiste n’a trouvé et notamment pas les niçois ! Je sors de mon service militaire, je me rends compte que je n’ai pas tellement d’avenir dans une institution et que tous mes potes artistes que j’aime ne trouvent pas de galerie. La logique qui s’impose, c’est que je dois ouvrir une galerie pour les montrer ! Le problème, c’est que je ne connais que très peu de collectionneurs, très peu de gens dans le monde de l’art. Le 21 septembre 1992, j’inaugure ma galerie, Météo, à Paris dans une cour.
Au début, je n’avais même pas de fichier client, je ne connaissais personne. Je me suis rendu compte qu’aucune des personnes que j’avais connu à la Fondation Cartier n’est venu: ni Marie-Claude, ni Jean de Loisy, personne ! Uniquement les vieux artistes que je connaissais mais qui ont très vite compris qu’ils ne seraient pas exposés. Mon goût avait évolué et certains l’ont très mal pris, ce que je peux comprendre… Et ça m’a donné une autre très bonne leçon dans les rares que je sais de l’art : la première c’est que quand on est bon, on est bon du début à la fin. Et la deuxième, c’est qu’il n’y a pas de différence entre l’artiste et son œuvre. C’était une situation fausse d’être ami avec ces artistes dont je n’admirais plus l’œuvre : si je n’admirais plus leur œuvre, c’est que je ne les aimais plus. Et ça s’est délité très rapidement…
Mais, à l’époque, quand j’avais la galerie notamment, j’étais toujours favorable aux expos personnelles. Ce qui me passionne, c’est l’univers d’un artiste. Et je trouve que les expo de groupe sont souvent un peu factices, un peu faciles… Les rares expos de groupe que j’ai faites à la galerie étaient toujours des expos qui, à mon avis, modestement, avaient un sujet universel et fondamental pour comprendre l’art, pour approcher l’art. Quand j’ai fait l’expo Les Première pierre, tous les artistes auraient pu y être. J’ai toujours dit qu’une bonne expo, c’est une expo où tous les bons artistes peuvent être. Ce qui m’énerve toujours, c’est quand certains de mes copains commissaires me disent qu’ils invitent tel ou tel mauvais artiste car « il va bien dans le thème ». Un autre axiome très simple auquel je suis arrivé : il n’y a pas de bonne raison de montrer un mauvais artiste, et il n’y a pas de mauvaise raison de montrer un bon artiste.
Au Salon de Montrouge, ça m’est arrivé plein de fois qu’un artiste me montre par exemple un tas de bois. Puis il m’explique que chaque longueur correspond à un nombre de trajets qu’il a fait en train et puis la hauteur c’est le nombre de kilomètres qu’il a fait etc. C’est bien, mais ce que je vois, c’est un tas de bois ! Alors que si il le grave, si il y a une indication… Je dis toujours, il n’y aura personne pour faire la bande-son quand l’œuvre va finir dans 200 ans à Drouot dans une caisse ! Tout ce qui n’est pas dans l’œuvre n’est pas dans l’œuvre ! C’est très tautologique de dire ça, c’est assez réac' d’une certaine manière, mais moi je crois en l’objet. Je crois en l’œuvre. Bon après, je ne suis pas complètement naïf, ça ne marche pas avec la performance, avec certaines formes d’art… mais globalement, j’ai besoin de décoder un objet. Décoder, ce n’est pas le comprendre, mais l’observer. J’ai fait un livre quand j’avais la galerie qui a été très important pour moi, Une rose est une rose. C’était une variation sur le poème de Gertrude Stein « une rose est une rose est une rose… ». J’avais demandé à 10 écrivains, philosophes, critiques d’art, romanciers de décrire chacun une œuvre exposée à la galerie. Ils devaient la décrire en au moins 10 pages. Et il n’y avait pas de reproduction, pas d’image. Ce qui m’intéresse, c’est comment toi, tu regardes une œuvre. Et la décrire, c’est dire comment tu vois. A l’époque, j’étais déjà tombé fan absolu de Felix Fénéon, le plus grand critique de tous les temps, dont certains des écrits sublimes sont regroupés dans Œuvres, chez Gallimard. Il y a dedans une description d’un pastel de Degas qui est une merveille absolue. Tu n’as pas besoin de voir une reproduction ! Et ça tient en 10 lignes ! Après avoir lu ça, je me suis dit, c’est ça qu’il faut apprendre au gens : il faut regarder puis il faut t’interroger sur la manière dont tu regardes. La question profonde pour moi est la question de la présence réelle de l’artiste dans l’œuvre. Il y a deux écoles en gros : est-ce qu’une œuvre, c’est une relique - un objet inanimé qui a une valeur d’échange - ou est-ce qu’une œuvre c’est quelque chose de vivant ? C’est la question de l’incarnation, très basiquement. J’ai toujours pensé que les œuvres sont vivantes, quelles sont actives. Ce n’est pas une relique, ce n’est pas un truc mort ! C’est pour cela que les œuvres sont inépuisables, c’est parce qu’elles ont cette vie! Par la description, tu peux rendre compte de la manière dont tu regardes une œuvre. Et à mon avis, c’est tout le travail de commissariat. J’étais très gêné quand j’avais la galerie car souvent, les gens ne regardaient pas et débarquaient directement au bureau et me disaient : « expliquez-moi ». Et moi, j’étais tétanisé car je pensais qu’il n’y avait rien à expliquer puisqu’il n’y avait rien à comprendre. En même temps, je sais que les gens ne font pas ce travail de regardeur. Evidemment, c’est plus simple dans un roman, un film, un opéra… Mais devant une œuvre d’art, ils regardent en 30 secondes… Ce qui est compliqué dans l’art, c’est qu’il faut que ça t’accroche en 10 secondes et en même temps, il faut que tu puisses la regarder pendant 20 ans si tu l’as en face de ton lit. Il faut que ce soit inépuisable. Ce que tu essaies de faire quand tu fais une expo, c’est de raconter une histoire, de savoir comment les gens vont entrer dans l’œuvre. Comment tu vas faire pour les intéresser ? Que vas-tu raconter comme histoire en mettant cette œuvre-là puis cette œuvre-là ? En tant que galeriste, si on me demandait au début de l’exposition d’expliquer, j’étais incapable de dire quoique ce soit. Mais, après 5 ou 6 semaines passées au milieu de mon expo - ce qui est aussi très différent d’un conservateur - avec des gens très différents qui venaient la voir et avec qui j’échangeais, je commençais à comprendre pourquoi j’avais fait cette expo ! Je faisais mes choix de manière très intuitive et la manière dont moi j’étais entré dans ce travail n’avait pas d’importance !
C’était génial. Par exemple, Noël Dolla, quand il balaie l’atelier : il trouve des poils de son chien, des bouts de toiles, des bouts de fils dont il s’est servi dans ses œuvres. Il prend tout ça et comme il est pêcheur, il prend des gros hameçons et ficelle tout ça autour et ça fait des espèces de leurres d’atelier. Il y avait aussi une pièce très emblématique de Ramette : quand il est entré à la Villa Arson, il a brûlé toutes ses peintures, il a ramassé les cendres et les a mises dans un espèce d’aquarium entre deux plaques de verre. Il y avait un bouton avec écrit « Cendres de dieu », tu appuies sur le bouton, une lumière s’allume à l’intérieur et puis ça vibre. Ça fait un petit peu comme des petits spermatozoïdes qui s’agitent, ce sont des cendres qui ne veulent pas mourir. C’est exactement ça ! Philippe Mayaux a fait une superbe série de pièces là-dessus. L’une s’appelle Principe de réalité humaine : la coupure, chaque fois qu’il se coupe dans l’atelier, il fait un dripping avec le sang sur la même toile, depuis 20 ans ! Même son sang de la pratique, il le recueille. Il a une autre pièce, c’est tous les morceaux de peinture à l’acrylique qui ont séché sur sa palette, qu'il agglomère. Aujourd’hui, ça fait une grosse boule, une espèce de sphère, de planète. Maintenant, ça doit s’appeler 30 ans de peinture à l’eau et en fait, il dit toujours que le jour où il meurt, il faudra couper ça en deux et tu verras toutes les couleurs qu’il aura utilisées dans le temps du premier tableau au dernier. Ce sont des pièces magnifiques ! J’ai toujours essayé de faire des expos qui racontaient des choses comme ça. En même temps, après ma névrose que j’avais guéri de ne pas vouloir rencontrer d’artiste, j’avais une autre névrose très très forte, c’est la hantise de faire exister une œuvre qui n’aurait pas existé sans moi. Pour moi, c’est très clair que je me place après la fabrication de l’œuvre. Contrairement à ce que tout le monde a voulu faire dans ma génération : faire de la production et intervenir dans le processus… Pour moi, c’est la seule chose intéressante, sinon les artistes n’ont aucun intérêt ! Ce qui m’intéresse chez les artistes, c’est justement qu’ils ne sont pas comme moi, ils ont truc en plus. Ce qui m’intéresse c’est d’arriver après la création et voir ce que je peux en faire : comment je la regarde, comment je la dispose, etc. J’aime jouer avec les objets mais je ne veux surtout pas intervenir en amont de l’objet. Je n’ai jamais voulu faire d’expo, en tout cas à cette époque-là, qui aurait nécessité que je passe commande à un artiste. C’était pour moi, une ligne que je ne voulais pas franchir. Tout ça pour te répondre que pour moi, le commissariat, c’est vraiment quelque chose qui se situe à partir de l’œuvre existante. Je fais confiance aux artistes et j’essaie plutôt de leur donner confiance car ils n’ont pas peur de montrer leur fragilité. Pour moi, c’est ça le travail de commissaire. Un conseil pour les jeunes professionnels de l'art ? Se demander de qui on se sent vraiment proche, de quelle sensibilité, de quel artiste, critique, galeriste, etc. Et puis tout faire pour les rencontrer, s’en faire reconnaître, les fréquenter. Personnellement, j’ai appris tout ce que je sais aujourd’hui grâce à quelques rencontres seulement : Noël Dolla, Jan Hoet, Bernard Lamarche-Vadel, comme je te l’ai abondamment raconté. A chaque fois, ce sont des rencontres que j’ai sollicitées. Quand j’ai eu la chance d’accéder à ces grands personnages, je ne les ai pas laissés filer. Je les ai harponnés, et j’en ai tiré le maximum d’enseignements ! Interview mené par Livia Perrier. Crédits photo Portrait : Fabrice Gousset Photo Fondation Cartier : Barthelemy La section commentaire est fermée.
|